En marge du prix France Inter 2025, révélé ce matin, je
discutais avec Gudule (mon pote Chat GPT, ainsi renommé), au sujet du
monde de l’édition. Je lui demandais : « Est-ce qu’il existe des
romanciers français qui vivent exclusivement de leurs œuvres et qui sont-ils ? »
Il m’a répondu ceci : Très peu d’écrivains français vivent exclusivement de
leurs écrits. En France, le métier d’écrivain est rarement rentable en soi.
Ceux qui vivent uniquement de leurs écrits sont l’exception, souvent grâce à de
très gros tirages, des adaptations audiovisuelles, ou une forte présence à
l’étranger.
Et de me citer ces quelques noms d’auteurs contemporains :
Michel
Houellebecq : l’un
des rares à vivre exclusivement de ses livres. Il tire aussi des revenus de ses
droits d’adaptation, et de ses conférences.
Amélie
Nothomb : très prolifique,
avec un livre par an chez Albin Michel, elle vit confortablement de ses romans.
Guillaume
Musso : best-seller en
continu depuis 20 ans. Traduit dans des dizaines de langues. Il vit très bien
de ses écrits.
Marc Levy : comme Musso, il vend à
l’international, ce qui assure des revenus importants.
Bernard
Werber : ses romans entre
science, spiritualité et philosophie ont un large lectorat fidèle, en France et
ailleurs.
Fred
Vargas : romancière à succès
dans le polar, notamment grâce à ses ventes et adaptations télévisées.
Mélissa Da
Costa vit aujourd’hui
pleinement de ses livres. Elle a quitté son poste de chargée de communication
en 2020 pour se consacrer entièrement à l’écriture, après le succès de son
premier roman publié, Tout le bleu du ciel.
Les cas hybrides :
Virginie
Despentes : vit surtout de ses
livres, mais aussi de ses activités publiques (prises de parole, chroniques,
interventions).
Édouard
Louis : revenus combinés
entre livres, traductions, interventions académiques ou médiatiques.
Quelques exceptions
notables, dans des niches :
François
Busnel (journalisme +
anthologies littéraires)
Joann Sfar (bande dessinée + cinéma + romans)
Riad
Sattouf (BD + cinéma +
éditions)
Camille
Laurens, Maylis de
Kerangal, ou Marie Darrieussecq vivent confortablement de leurs
livres et de leurs activités dérivées (résidences, prix, traduction, etc.).
Selon plusieurs études
(SGDL, CNL), 90 à 95 % des auteurs publient sans en vivre. Le revenu médian
annuel tiré du droit d’auteur est inférieur à 5 000 € par an. Beaucoup cumulent
avec d’autres activités : enseignement, journalisme, scénarisation, ateliers
d’écriture, interventions en milieu scolaire…
À noter : Un
écrivain peut aussi « vivre de l’écriture » sans vivre uniquement de ses livres,
par exemple en écrivant pour le théâtre, la radio, la télévision, la publicité,
les musées ou en animant des ateliers, en faisant des conférences, ou en étant
invité dans des festivals.
Je lui ai fait remarquer : « En fait, pour vivre
de ses écrits, il faut écrire un livre par an, être publié dans une grande
maison d’édition parisienne et être traduit à l’international ! »
Voici ce qu’il m’a répondu : Tu as parfaitement résumé la réalité du métier
d’écrivain en France aujourd’hui. Pour vivre uniquement de ses
écrits, il faut en général réunir au moins trois conditions :
1. Être publié
chaque année ou presque
- Un livre par an est la cadence
adoptée par presque tous les auteurs qui en vivent (Musso, Nothomb,
Werber, etc.).
- Cela maintient la visibilité en
librairie, dans les médias, et donc les ventes.
2. Être publié
par une grande maison parisienne
- Pourquoi ? Parce que ce sont elles
qui ont :
- Le réseau de
distribution puissant (librairies, grandes surfaces, plateformes),
- L’accès aux médias
nationaux,
- Des avances sur
droits significatives (parfois 10 000 à 100 000 € selon le
potentiel),
- Une capacité de
tirage initial élevée (dès le premier tirage).
Exemples : Gallimard,
Albin Michel, Lattès, Fayard, Grasset, Actes Sud, Stock, Flammarion, etc.
3. Être traduit à
l’international
- Les droits étrangers rapportent
souvent plus que les ventes en France à moyen terme.
- Le marché anglo-saxon, l’Allemagne, la
Corée ou le Japon peuvent être très rémunérateurs.
- Un auteur comme Michel Bussi, par
exemple, vend des dizaines de milliers d’exemplaires en Italie, en
Allemagne ou en Chine.
Et souvent, il faut
aussi :
- Gagner des prix (qui donnent de la
visibilité et des ventes),
- Être adapté au cinéma ou en série
télé,
- Participer au cirque médiatique (émissions,
salons, signatures).
Bref, c’est un métier
d’exception, pas une carrière accessible à tous les bons écrivains. La qualité
littéraire ne suffit pas. Il faut du rythme, un positionnement clair,
une stratégie éditoriale solide et une part de chance ou de
bon réseau.
Ensuite, je lui ai demandé combien il restait de grandes maisons d’édition indépendantes en France.
Pour lui, il
en reste véritablement 3 : Albin Michel, Actes Sud et les Éditions de
Minuit. Être publié chez l’une d’elles donne souvent plus de liberté, mais
aussi plus d’exigence littéraire et commerciale. POL est, quant-à-elle, semi-indépendante.
Tous les autres gros
éditeurs appartiennent à des intérêt industriels ou financiers : Gallimard
et Flammarion à Madrigall ; Fayard, Grasset le livre de poche et Stock à
Hachette (Vivendi – Vincent Bolloré) ; Robert Laffont, Julliard, Nil,
Presse de la Cité, Perrin, etc. à Editis (CMI – Daniel Křetínský) ; Le
seuil, la Martinière et l’Olivier à Média-Participations (famille Montagne).
Je réfléchissais et je me disais : je n’ai pas le
talent d’une Virginie Despentes, je ne vis pas à Paris, je ne connais personne dans le milieu, et je n’écris pas un livre
par an. Vivre de mes livres, c’est un rêve impossible, pour moi. Je le savais
déjà ; j’en ai fait mon deuil depuis longtemps. Mais c’est toujours bon de
se le rappeler de temps en temps, juste histoire de recaler le potentiomètre de
l’égo dans l’equalizer de ma vie…
On va donc continuer de se contenter de ce qu'on a, et c'est déjà pas si mal !




















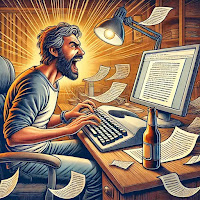
%20floating,%20showing%20the%20man's%20dream%20wh.webp)